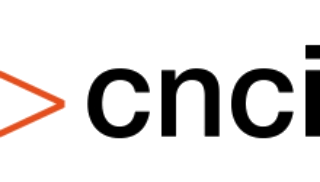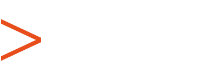Laila Cinotti, Economiste d’entreprise ESG, au bénéfice d’un CAS en management entrepreneurial, affiche plus de 25 ans d’expérience bancaire, dont 20 au profit des PME du Canton de Neuchâtel. En 2023, avec Frédéric Bigler, elle a créé Bigler & Cinotti, une société de services qui propose son accompagnement dans la recherche de tous types de financement pour les PME. Depuis le 1er juillet 2025, l’entreprise a accepté un mandat de Cautionnement Neuchâtel. Laila Cinotti est devenue Directrice de cette antenne. Dans le cadre d’un événement d’entreprise coorganisé par Cautionnement Neuchâtel et la CNCI, Laila Cinotti a commenté les résultats de l’étude conjoncturelle de la CNCI, consacré à la trésorerie et à l’endettement des entreprises membres de la CNCI. Elle revient sur cette étude et répond à nos questions.
Par rapport aux résultats de l’enquête de la CNCI, quelles sont vos premières observations ? Qu’est-ce qui vous étonne ? Qu’est-ce qui confirme ce que vous vivez sur le terrain ?
Il y a peu de surprise. Les résultats correspondant à la situation économique au sortir de l’année 2024. La crise se faisait déjà sentir, mais 2023 ayant été une année globalement très positive, les liquidités étaient encore satisfaisantes. La dégradation est très progressive mais réelle. Ce phénomène n’est pas spectaculaire, mais il est clairement visible, et il correspond parfaitement à ce que nous observons sur le terrain : des marges sous pression, des coûts fixes qui ont beaucoup augmenté depuis 2022 et des cycles d’encaissement qui se tendent.
Ce qui m’a davantage étonnée, en revanche, c’est la résilience d’une partie du tissu industriel, malgré un contexte économique plutôt incertain. Certaines entreprises ont manifestement réussi à maintenir une structure financière solide en anticipant mieux leurs besoins en liquidités ou en optimisant leurs stocks.
Il faudra être vigilant en 2026 car la sortie de la crise ne se dessine pas encore, et bien que leur durée ait été prolongée, la fin des RHT va commencer à toucher certaines entreprises. Les liquidités risquent de commencer à manquer même chez celles qui avaient le plus de réserves.
Enfin, l’enquête confirme un point que nous constatons quotidiennement : les petites entreprises – surtout celles de moins de 30 collaborateurs – sont les plus vulnérables et les plus exposées au manque de garanties lorsqu’il s’agit de solliciter un crédit bancaire. La taille reste un facteur déterminant dans l’accès au financement. C’est régulièrement le propriétaire et souvent patron de l’entreprise qui va devoir s’engager sur ses biens personnels pour obtenir un financement.
Cette étude a été réalisée au premier trimestre 2025. D’après vous, qu’est-ce qui pourrait avoir changé à la fin novembre 2025 par rapport à cette période ?
Le monde a changé en lien avec les différentes annonces au sujet du niveau de taux des droits de douane car Neuchâtel est un canton essentiellement exportateur.
Deux éléments ont probablement évolué depuis le printemps :
- La trésorerie. La seconde moitié de l’année est souvent plus tendue : augmentation saisonnière des besoins en fonds de roulement, ralentissement des paiements en fin d’année, et incertitudes économiques qui poussent les entreprises à constituer un “coussin” de sécurité. On peut donc s’attendre à ce que les positions de trésorerie de nombreuses PME soient un peu plus fragiles qu’au début de l’année.
- L’accès au crédit. Les banques, dans un contexte post-fusion bancaire et avec une réglementation toujours plus stricte, ont tendance à renforcer leurs exigences en matière de garanties et de ratios financiers. Les demandes de crédit qui paraissaient acceptables au printemps peuvent avoir rencontré davantage de réticences en fin d’année, surtout pour les petites structures.
Globalement, je dirais que les tensions se sont accrues, mais de manière maîtrisable, à condition pour les entreprises d’avoir anticipé leurs besoins.
Selon l’étude de la CNCI, les délais de paiement des clients se montent à 40 jours pour l’industrie et à 35 pour les services. Sont-ils en passe de s’allonger, en cette fin d’année ? Qu’entendez-vous de vos clients à ce sujet ?
Oui, on observe une tendance à un léger allongement des délais, surtout dans les secteurs où la chaîne de valeur est déjà sous pression. Plusieurs entreprises nous rapportent que certains clients prennent 10 à 20 jours de plus pour régler, parfois sans l’annoncer. Ce n’est pas encore une dérive massive, mais c’est suffisant pour créer des tensions de trésorerie dans les petites structures.
Les entreprises qui dépendent de grands donneurs d’ordre industriels nous signalent aussi des comportements plus prudents : les paiements restent globalement dans les normes, mais leur variabilité augmente. Et c’est bien cette variabilité qui déstabilise le financement du quotidien. Dans les services, c’est plus hétérogène : certaines activités B2B sont plus fortement touchées, alors que les services à forte récurrence de facturation s’en sortent plutôt bien.
Selon l'étude, plus de 15% des entreprises industrielles et de moins de 30 collaborateurs ont des difficultés à obtenir des crédits. L’observez-vous aussi dans le cadre de vos activités ? En quoi la disparition d’une banque comme le Credit Suisse pourrait avoir une influence sur ces difficultés?
Ces difficultés se retrouvent très clairement dans notre activité. Les petites entreprises industrielles cumulent trois handicaps :
- Des garanties limitées
- Des cycles de trésorerie parfois longs
- Et des investissements matériels coûteux
Elles sont donc davantage confrontées à des refus de crédit, ou à des demandes de garanties personnelles qui dépassent leurs capacités.
Concernant la disparition de Credit Suisse, l’impact est réel, même s’il est indirect. La fusion a réduit la diversité des approches de risques sur le marché suisse. L’un des grands acteurs historiques, qui avait ses propres critères et stratégies de soutien aux PME, n’est plus présent. Cela crée mécaniquement une forme d’uniformisation des pratiques de crédit, généralement plus prudentes, ce qui renforce la difficulté pour les plus petites industries.
Dans ce contexte, le rôle des dispositifs de cautionnement est encore plus crucial qu’avant : ils permettent d’atténuer cet effet de concentration bancaire et redonnent un accès au crédit à des entreprises viables mais insuffisamment garanties.
Quels conseils donnez-vous aux entreprises pour trouver le meilleur mix entre trésorerie et endettement ?
Je recommande toujours aux entreprises de commencer par analyser leur cycle de trésorerie. Plus ce cycle est long, plus elles doivent sécuriser un matelas de liquidités. Ensuite, il est essentiel d’associer le bon type de financement au bon type de besoin : les investissements durables doivent être financés par des crédits à long terme, tandis que les besoins liés à l’exploitation – comme les stocks ou les délais clients – doivent être couverts par des lignes de trésorerie. Enfin, je conseille de sécuriser les financements avant qu’une tension n’apparaisse. Une entreprise obtient toujours plus facilement un crédit lorsqu’elle est dans une phase stable.
Quels conseils donnez-vous aux entreprises pour se donner un maximum de chances d’obtenir des crédits ?
La clé, c’est un dossier solide et transparent. Les banques apprécient un business plan clair, des comptes fiables et un budget de trésorerie crédible. Montrer que l’entreprise maîtrise ses chiffres fait souvent la différence.
Ensuite, si possible, un apport en fonds propres reste déterminant en Suisse : il prouve l’engagement du dirigeant.
Enfin, je suggère aux entrepreneurs d’anticiper la question des garanties. Mentionner spontanément le recours possible à Cautionnement Neuchâtel rassure souvent le banquier, car cela montre que l’entreprise connaît les outils existants et prépare sérieusement sa demande.
Pour les crédits, on parle d’abord des banques. Quelles sont les autres alternatives ?
Les banques restent incontournables, mais ce ne sont plus les seules options. Les cautionnements – comme celui proposé par Cautionnement Neuchâtel – sont une alternative très efficace pour les entreprises qui manquent de garanties.
On peut également citer le leasing, intéressant pour les équipements, les plateformes de financement participatif, les investisseurs privés ou encore certaines fondations cantonales qui soutiennent l’innovation ou la création d’entreprise. Le paysage du financement est diversifié, et c’est une opportunité pour les PME, mais encore faut-il qu’elles en aient connaissance.
Comment Cautionnement Neuchâtel soutient les entreprises pour obtenir des crédits auprès des banques ? Quelle sont les conditions ?
Cautionnement Neuchâtel ne prête pas directement de l’argent, mais garantit une grande partie du risque que la banque prend. Cela permet à des entreprises viables mais insuffisamment garanties d’accéder au crédit.
Pour être soutenue, l’entreprise doit présenter un projet crédible, offrir ou créer des emplois, être active dans le canton de Neuchâtel et démontrer sa capacité à rembourser. Cautionnement Neuchâtel s’intéresse aussi à l’implication du dirigeant : le financement fonctionne d’autant mieux que l’entrepreneur participe au risque, notamment par un apport personnel ou une arrière-caution.
Quelles tailles ont les entreprises qui recourent aux services de Cautionnement Neuchâtel et dans quels secteurs d’activités se trouvent-elles?
Il s’agit principalement de PME, souvent entre 1 et 50 collaborateurs, mais pas uniquement. On trouve des sociétés industrielles, des entreprises de services, des commerces, des restaurants, et de nombreuses activités artisanales. Toutes n’ont pas le même niveau de garanties, mais elles ont un point commun : un projet solide nécessitant un financement pour se développer, investir ou simplement stabiliser leur exploitation
Pour quels types d’opération Cautionnement Neuchâtel soutient les entreprises ?
Le champ est large. Cautionnement Neuchâtel soutient aussi bien des crédits d’investissement pour des machines, des locaux ou des équipements, des crédits d’exploitation destinés à financer la trésorerie, les stocks ou la croissance. Il peut aussi intervenir lors de créations ou de transmission d’entreprises qui sont souvent des moments sensibles en termes de financement. Il peut également être impliqué dans l’immobilier en cas d’acquisition ou de travaux du bien immobilier en lien avec l’exploitation. L’objectif reste le même : permettre au banquier d’accompagner un projet économiquement sain.
Vous dites que les banques ne proposent pas systématiquement le cautionnement, quitte à finalement ne proposer aucun crédit. Quelles en sont les raisons ? Et que fait Cautionnement Neuchâtel pour éviter ce genre de situation ?
Plusieurs raisons expliquent cela. Certains conseillers bancaires ne connaissent pas encore suffisamment bien le cautionnement ou pensent qu’un projet trop risqué ne vaut pas la peine d’être étudié, même avec une garantie. D’autres estiment que le processus demande plus de travail interne.
Cautionnement Neuchâtel agit sur ces points en formant activement les banques, en simplifiant les démarches et en restant disponible pour discuter des dossiers en amont. Nous encourageons aussi les entreprises à nous contacter directement si elles pensent qu’un cautionnement peut faire la différence. Cela permet d’éviter que des projets viables soient abandonnés trop tôt.
Qui doit d’abord savoir que Cautionnement Neuchâtel existe ? La banque ou l’entreprise ? Et pour quelles raisons ?
Idéalement, les deux ! L’entreprise doit connaître le cautionnement pour pouvoir l’évoquer spontanément lors de sa démarche de financement. Cela montre une bonne préparation et peut débloquer des situations. La banque, de son côté, doit maîtriser l’outil pour savoir rapidement quand le proposer et comment monter un dossier efficace. Quand les deux parties connaissent bien le mécanisme, le financement devient plus rapide, plus simple et surtout plus accessible.
Présentations
Résultats enquête CNCI sur la trésorerie et endettement (printemps 2025)
Présentation de Cautionnement Neuchâtel